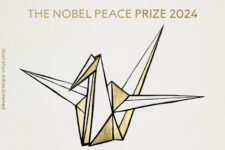Par Mathilda Caron et Tinah Rakotoarimanga
Le 19 novembre 2024, Vladimir Poutine a signé une mise à jour majeure de la doctrine nucléaire russe. Cette initiative, lancée deux ans après le début de la guerre contre l’Ukraine, aurait pu s’apparenter à une simple manœuvre bureaucratique. Il s’agit en réalité d’un message clair adressé à l’Occident : la Russie est prête à élargir les conditions dans lesquelles elle pourrait recourir à l’arme nucléaire. Cette évolution marque un tournant majeur, car jusqu’à présent, la doctrine nucléaire de Moscou stipulait que le recours à l’arme nucléaire ne pouvait intervenir qu’en cas de menace « existentielle » pour l’État russe. Avec cette nouvelle doctrine, les lignes rouges de Moscou se redéfinissent, augmentant le risque d’escalade dans un contexte particulièrement tendu avec l’Occident.
1. L’Ukraine, catalyseur du durcissement nucléaire russe
Depuis le début de la guerre en Ukraine, en février 2022, la Russie a considérablement intensifié sa rhétorique nucléaire. Vladimir Poutine et ses ministres ou conseillers ont brandi à plusieurs reprises la menace d’un recours à l’arme nucléaire pour dissuader les puissances occidentales de soutenir militairement Kiev. « Deux cents menaces explicites de recours au nucléaire par la Russie ont été recensées depuis le début de l’invasion de l’Ukraine », rappelle Marc Finaud[1]. Cette posture s’inscrit dans une logique d’ambiguïté stratégique, visant à semer l’incertitude sur les lignes rouges de Moscou et à dissuader toute escalade adverse. Dans ce contexte, les relations entre la Russie et l’OTAN ont atteint un niveau de tension inédit depuis la guerre froide. Les livraisons d’armes lourdes à l’Ukraine et les discussions sur l’avenir de la sécurité européenne ont alimenté le récit russe d’un encerclement occidental menaçant la souveraineté du Kremlin.
En novembre 2024, la décision de l’administration Biden d’autoriser l’Ukraine à utiliser des missiles ATACMS à longue portée contre des cibles situées sur le territoire russe a probablement accéléré la publication de la nouvelle doctrine. De même, les missiles SCALP français et Storm Shadow britanniques « redeviennent un outil de compétition stratégique, comme à la fin de la guerre froide », expliquaient Héloïse Fayet et Léo Péria-Peigné, chercheurs à l’Ifri[2]2. Dans le même temps, la Russie a multiplié les signaux de sa volonté de redéfinir les équilibres nucléaires. Par ailleurs, les annonces concernant le déploiement d’armes nucléaires tactiques au Bélarus, le retrait de plusieurs traités de contrôle des armements, et la tenue d’exercices nucléaires conjoints illustrent cette dynamique. La publication de la nouvelle doctrine nucléaire s’inscrit donc dans une double temporalité : une réaction immédiate à l’évolution du conflit en Ukraine, et une stratégie de long terme visant à redéfinir le rapport de forces avec l’Occident.
2. Vers une doctrine d’emploi élargie : éléments nouveaux et seuils redéfinis
Depuis mi-2023, deux courants s’affrontent en Russie sur la question de la crédibilité de la dissuasion nucléaire : l’un reproche aux autorités d’avoir banalisé la menace nucléaire par des déclarations répétées, affaiblissant son efficacité et sa crédibilité, tandis qu’un autre estime que les Occidentaux ont perdu la crainte du nucléaire, et recommande de durcir la doctrine.
Plusieurs ajouts marquent ce potentiel durcissement. Désormais, une attaque menée par un État non doté avec le soutien d’une puissance nucléaire sera considérée comme une attaque conjointe susceptible de réponse nucléaire. Auparavant, la charge était inversée : la Russie privait de sa « garantie négative de sécurité » (promesse de non-attaque de pays non nucléaires) les membres d’une alliance telle l’OTAN agissant en association avec une puissance nucléaire dans une agression contre la Russie. Le seuil d’emploi est donc abaissé : une agression conventionnelle contre la Russie ou la Biélorussie menaçant leur souveraineté ou leur intégrité territoriale peut justifier le recours au nucléaire. La Biélorussie est explicitement couverte par la dissuasion nucléaire, quel que soit le type d’attaque, actant son intégration stratégique avec la Russie.
Une attaque d’un pays membre d’une alliance militaire contre la Russie ou ses alliés sera donc considérée comme une attaque de l’alliance dans son ensemble. La doctrine traduit également une volonté de redéfinir les règles du jeu sécuritaire avec l’OTAN, dans un contexte de renforcement de celle-ci (adhésion de la Finlande et de la Suède, redéploiements militaires vers l’est). Moscou anticipe une montée en puissance du rôle du nucléaire dans sa posture défensive, face à une infériorité conventionnelle croissante.
Désormais, une attaque conventionnelle sur la Russie ou la Biélorussie, si elle est perçue comme une menace « critique » à leur souveraineté, pourrait suffire pour justifier une réponse nucléaire. Autrement dit, plus besoin d’attendre que Moscou soit au bord de l’effondrement : si le Kremlin juge que son territoire ou celui de son allié biélorusse est trop menacé, il se réserve le droit de déclencher le feu nucléaire.
3. L’intégration stratégique de la Bielorussie dans la posture nucléaire russe
Ce qui est frappant dans cette nouvelle doctrine, c’est la place de la Biélorussie. Auparavant, la Russie parlait vaguement de protéger ses alliés, mais maintenant, c’est écrit noir sur blanc : une attaque contre la Biélorussie pourrait déclencher une riposte nucléaire russe, même si elle n’est que conventionnelle. Pourquoi insister autant sur Minsk ? Parce que depuis que Loukachenko a accepté le déploiement d’armes nucléaires russes sur son territoire en 2023, la Biélorussie est devenu un maillon clé de la stratégie nucléaire de Moscou. En intégrant officiellement ce pays sous son parapluie nucléaire et en l’utilisant comme base avancée de son dispositif nucléaire (sur le modèle du « partage nucléaire » des États-Unis avec cinq pays de l’OTAN), la Russie envoie un message à l’Alliance atlantique : « Ne touchez pas à la Biélorussie, sinon vous nous touchez aussi. » Et comme ce pays est frontalier de la Pologne, de la Lituanie et de la Lettonie, autant dire que les Européens ont de quoi s’inquiéter.
4. La réponse doctrinale russe face au renforcement de l’Alliance
Un autre passage clé de la doctrine met les choses au clair : « Une attaque contre la Russie ou ses alliés par un État membre d’un bloc militaire sera considérée comme une attaque de tout le bloc. » En gros, si un seul pays de l’OTAN dépasse la ligne rouge russe, Moscou considérera que c’est toute l’Alliance qui l’attaque. On comprend vite que cette phrase vise directement Washington, Paris, Londres, Berlin… Bref, tous ceux qui envoient des armes à l’Ukraine. Et ce n’est pas tout : si un pays non-nucléaire attaque la Russie avec l’aide d’un pays qui possède l’arme nucléaire, Moscou pourra y voir une « attaque conjointe ». Là encore, c’est un avertissement aux Occidentaux : « Continuez à armer l’Ukraine, surtout avec des missiles capables d’atteindre la Russie, et vous risquez de franchir une limite dangereuse. »
C’est un vrai problème pour Moscou : si l’Occident considère que la Russie ne va jamais réellement utiliser ses armes nucléaires par crainte d’une riposte dévastatrice, alors sa dissuasion perd toute crédibilité. En durcissant sa doctrine, Poutine cherche à remettre la peur du nucléaire au centre du jeu.
Preuve que la Russie veut être prise au sérieux, elle a tiré un missile balistique expérimental sur la ville ukrainienne de Dnipro quelques jours après l’annonce de cette doctrine. Le message est clair : « Nous sommes prêts à aller plus loin si nécessaire. »
5. L’ambiguïté stratégique comme outil de dissuasion renouvelée
La vraie question est de savoir si la nouvelle doctrine est du bluff ou si le risque d’escalade nucléaire est réel. Et la réponse n’est pas si évidente. D’un côté, Poutine joue énormément sur l’ambiguïté. Il veut que personne ne sache vraiment où se situe la vraie limite, afin que les Occidentaux hésitent à aller trop loin.
Mais d’un autre côté, il existe un risque que cette stratégie se retourne contre lui. Si l’Occident continue de tester ses lignes rouges sans conséquences, la dissuasion russe pourrait s’effriter. Et dans ce cas, Moscou pourrait être tentée de prouver qu’elle ne plaisante pas, par exemple avec une démonstration de force en utilisant une arme nucléaire à faible puissance. On n’en est pas encore là, mais cette doctrine montre que la Russie est prête à tout pour maintenir son influence et empêcher l’Ukraine de renverser la situation. À voir si l’Occident tombera dans le piège de la peur, ou s’il continuera à grignoter l’espace stratégique russe…jusqu’au point de non-retour.
La doctrine nucléaire russe a toujours été un outil stratégique autant qu’un message politique. Mais celle de 2024 marque un tournant. Ce n’est pas une simple mise à jour technique, c’est un signal clair envoyé à l’Occident : les règles du jeu changent, et Moscou veut que tout le monde le comprenne. Jusqu’à présent, la Russie affirmait qu’elle ne recourrait à l’arme nucléaire qu’en cas de menace « existentielle » pour l’État. C’était une ligne rouge bien définie : si la Russie n’était pas sur le point de s’effondrer, elle n’appuierait pas sur le bouton.
La nouvelle doctrine change complètement cette logique. Désormais, une attaque conventionnelle peut justifier une riposte nucléaire si elle représente une « menace critique » pour la souveraineté ou l’intégrité territoriale de la Russie ou de la Biélorussie. Concrètement, la définition de la menace est floue et c’est volontaire. Cela permet à Moscou de laisser planer le doute sur le moment où elle pourrait considérer qu’un seuil est franchi. C’est une stratégie de dissuasion par l’ambiguïté : personne ne sait exactement jusqu’où aller sans risquer une escalade.
La Russie a toujours évoqué la protection de ses alliés de manière vague. Cette fois, elle inscrit noir sur blanc que toute attaque contre la Biélorussie pourra entraîner une riposte nucléaire, même si elle est purement conventionnelle. Ce que cela signifie : la Russie veut verrouiller l’intégration stratégique de la Biélorussie. Depuis que Minsk a accepté le déploiement d’armes nucléaires russes sur son sol en 2023, il est devenu un maillon essentiel du dispositif militaire russe en Europe. Cela signifie aussi que tout affrontement impliquant la Pologne ou les pays baltes avec la Biélorussie pourrait théoriquement dégénérer en crise nucléaire. Jusqu’ici, la doctrine nucléaire russe parlait d’attaques contre la Russie sans forcément préciser qui les mènerait. Maintenant, elle cible explicitement les alliances militaires. D’une part, elle prévoit que si un pays membre d’un bloc militaire attaque la Russie, c’est toute l’alliance qui sera considérée comme ennemie. D’autre part, elle indique que si un pays non nucléaire attaque la Russie avec le soutien d’une puissance nucléaire, Moscou pourra considérer cela comme une attaque conjointe. C’est un message direct à l’OTAN et aux États-Unis. En clair, la Russie met en garde contre toute forme d’aide militaire trop agressive à l’Ukraine. Cela signifie aussi que si un pays de l’Alliance franchit une limite définie par Moscou, cela pourrait entraîner une escalade globale et non plus un simple conflit régional.
Les doctrines russes précédentes faisaient encore référence aux efforts de maîtrise des armements et aux traités internationaux qui limitaient la prolifération nucléaire ou imposaient des plafonds aux arsenaux des deux principales puissances nucléaires. Dans la version 2024, ces mentions disparaissent totalement. C’est cohérent avec la politique récente de Moscou : suspension du traité New START sur les armes nucléaires stratégiques, retrait de la ratification du Traité d’interdiction complète des essais nucléaires, et refus de tout dialogue avec l’Occident sur ces sujets. Ainsi, la Russie se donne les mains libres pour moderniser son arsenal et potentiellement reprendre des essais nucléaires si elle le juge nécessaire.
Cela ouvre la porte à une nouvelle course aux armements, où chaque camp cherchera à augmenter sa puissance de frappe sans contrainte diplomatique. Ce texte ne se contente pas de poser un cadre juridique, il est conçu comme un message politique destiné à restaurer l’effet de dissuasion de la Russie.
[1] Gérald Papy, « La Russie affine sa doctrine au cas où… »), Le Vif, 3 octobre 2024.
[2] L’Express, « Guerre en Ukraine : ‘Les missiles à longue portée redeviennent un outil de compétition stratégique’ », 19 novembre 2024